Une histoire des Etats-Unis, au-delà de la réaction populiste à la crise mondiale de 2008, devrait s’efforcer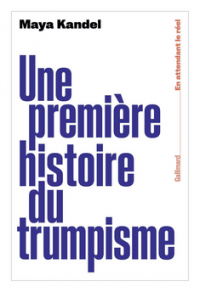 d’expliquer pourquoi l’espoir d’avènement d’une démocratie aux Etats-Unis, formulé à la fin du XIXe siècle par le publiciste libéral A. de Tocqueville, pourquoi cet espoir a été très tôt déçu ? Autrement dit, comment un régime oligarchique démagogique a-t-il pu s’imposer au lieu de la démocratie espérée ?
d’expliquer pourquoi l’espoir d’avènement d’une démocratie aux Etats-Unis, formulé à la fin du XIXe siècle par le publiciste libéral A. de Tocqueville, pourquoi cet espoir a été très tôt déçu ? Autrement dit, comment un régime oligarchique démagogique a-t-il pu s’imposer au lieu de la démocratie espérée ?
Il n’est pas inutile de rappeler certaines caractéristiques de l’utopie démocratique de Tocqueville. Cet aristocrate normand est peut-être le seul Français à jamais avoir été (sincèrement) enthousiasmé par le projet de démocratie en Amérique du Nord, teinté de rousseauisme.
Néanmoins Tocqueville n'était pas un optimiste béat ; il avait entrevu le risque que la jeune confédération d’Etats courait d’évoluer vers un régime oligarchique ; il qualifie cette menace dans « De la Démocratie » « d’aristocratie de l’argent ». Tocqueville avait foi aussi dans l’adoucissement des mœurs démocratiques, à quoi la guerre dite « de Sécession », quelques années à peine après la mort de l’essayiste, oppose un démenti cinglant ; les historiens tiennent en effet cette guerre civile comme l’une des premières, si ce n’est LA première guerre « totale », engageant cruellement toutes les forces vives des deux partis opposés. Le fait de la violence démocratique est établi dès la fin du XIXe siècle, et ne se démentira pas par la suite.
La violence verbale de Donald Trump, pour ne pas dire sa vulgarité, qui galvanise son électorat, ne doit pas faire oublier que l’hypocrisie du parti oligarchique adverse contribue largement, elle aussi, à la violence, notamment sur le plan international où les « droits de l’homme » servent à maquiller la cause impérialiste de motifs humanistes. Agressée verbalement par D. Trump, l’actuelle présidente du Mexique a répliqué en rappelant tout ce que l’extraordinaire violence qui règne au Mexique (nation officiellement « en paix ») doit à son puissant voisin, trafiquant d'armes international.
Les médias européens oublient de rappeler que le droit de détenir des armes à feu est un droit essentiellement démocratique. Si le parti démocrate apparaît comme moins violent, plus policé, c’est parce qu’il est le parti de la délégation de la violence au pouvoir exécutif., suivant le droit européen. La violence des MAGA est bel et bien « révolutionnaire ».
Significativement, l’utopie démocratique de Tocqueville est une utopie anti-européenne, en rupture avec la formule politique de l’Etat moderne (théorisé vers 1650). Tocqueville ne se satisfaisait pas de l’Etat « tout-puissant », tel qu’il s’était imposé en France en dépit de la Révolution bourgeoise et des aspirations des Lumières à la décentralisation. Cet aspect « anti-européen » se retrouve dans la révolution MAGA, les électeurs de D. Trump étant enclins à voir dans les nations européennes des nations colonialistes belliqueuses, pour ne pas dire génocidaires.
L’ouvrage de Maya Kandel est focalisé sur les campagnes et les victoires successives de Donald Trump, et fait assez largement fi du contexte historique. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle accorde à l’idéologie MAGA/trumpiste une importance excessive. Qu’il soit antisémite ou au contraire sioniste comme celui de Trump, « wokiste » ou « antiwokiste », le discours démagogique opère comme un levain sur les masses, suivant l’observation de George Orwell ; l’idéologie est la carrosserie du populisme, non son moteur. M. Kandel dit bien que le trumpisme n’est pas assimilable au fascisme, mais elle ne dit pas précisément pourquoi : le trumpisme n’est pas assimilable au fascisme car les Etats-Unis ne sont pas une nation en expansion industrielle comme le IIIe Reich ou l’Italie de Mussolini, mais au contraire une nation en récession.
Steve Bannon, dont M. Kandel explique comment il est devenu l’idéologue en chef de Donald Trump, à qui il a inspiré les slogans politiques les plus efficaces, n’est jamais qu’un publicitaire de plus au pays du marketing politique. Le krach de 2008, dont M. Kandel sous-estime les répercussions, a joué en la faveur des slogans de Steve Bannon et Donald Trump dans la mesure où la démagogie wokiste antagoniste peut se résumer au slogan de la mondialisation heureuse (dont A. Huxley a produit la caricature dès 1932).
Le capitalisme sans filtre en vigueur aux Etats-Unis a eu pour conséquence de mobiliser une large partie de la classe moyenne, frappée durement par la crise, contre l’appareil d’Etat de Washington, qui finance la propagande wokiste par le biais de fondations philanthropiques privées ou publiques. L’ascension politique de Donald Trump résulte donc autant de la sclérose des partis institutionnels, absorbés par leurs visées impérialistes, que de l’opportunisme de S. Bannon, sa capacité à canaliser les aspirations des « White Trash » (petits blancs déclassés) et d’une partie de la communauté hispanique au sein de laquelle les slogans wokistes n’ont que peu d’écho.
M. Kandel se laisse happer par l’idéologie et entre trop dans le détail du « marketing politique » MAGA ; l’étude d’un phénomène idéologique ou politique, isolé de son contexte historique, revient à n’étudier que la partie visible de l’iceberg. Le seul intérêt de cette enquête fouillée sur la stratégie électorale des MAGA est qu'elle souligne à quel point l’électorat de D. Trump est hétéroclite : contrairement à la promesse de restauration de l’économie américaine sur le déclin, les slogans antiwokistes mobilisent surtout le noyau dur des fondamentalistes évangélistes, hostiles à la société de consommation en laquelle ils voient le prolongement du satanisme européen (catholique romain). D. Trump, qui n’a rien lui-même d’un fondamentaliste, a paradoxalement su capter cet électorat puritain, qui reste sans doute très méfiant (le jeune assassin de D. Trump était lui-même membre d’une secte chrétienne fondamentaliste, et la thèse de sa manipulation par les services secrets est peu probable).
La diversité de cet électorat, regroupé derrière le slogan fourre-tout « Make America Great Again » rendra la mission que s’est assigné D. Trump de restaurer la suprématie des Etats-Unis d’autant plus difficile. Cette fragilité électorale pourrait entraîner le camp MAGA à se radicaliser encore plus ; le camp démocrate adverse, « éparpillé » par la répression des Palestiniens de la bande de Gaza, d’une violence inouïe, cautionnée par le président Joe Biden et la candidate Kamala Harris, pourrait lui aussi se radicaliser pour faire oublier sa contribution à une guerre impérialiste brutale.
Un détail surprenant dans l’analyse de M. Kandel, à la limite de la mauvaise foi, est l’accusation lancée à D. Trump d’opposer systématiquement la fiction à la réalité. Ce procédé n’est pas celui de Donald Trump, mais celui des Etats-Unis tout entier ! Les Etats-Unis sont une nation de plaideurs, et ils l’ont toujours été. A qui D. Trump devrait-il demander la permission de s’affranchir de la réalité ? A Hollywood ?
M. Kandel considère le trumpisme comme le phénomène politique majeur du début du XXIe siècle ; c’est d’autant plus vrai que la crise mondiale a entraîné, dans l’ensemble des pays occidentaux, des bouleversements sociaux analogues à ceux qui ont produit la victoire de D. Trump : on l’a déjà presque oublié, mais la première campagne d’E. Macron était largement « antisystème », avant que le président français n’apparaisse rapidement comme un champion de la politique économique planifiée à partir de Bruxelles, à l’instar de ses prédécesseurs. La promesse de réindustrialiser la France fut faite AVANT celle de Donald Trump d’en faire de même.
Plutôt que de révolution « libérale-conservatrice », suivant la dénomination retenue par l’essayiste, on caractérisera mieux la conquête du pouvoir fédéral par les MAGA comme "une révolution capitaliste anticapitaliste" ; ainsi la contradiction du programme politique MAGA apparaît comme étant plus économique qu’idéologique. L’utopie MAGA est une sorte de retour vers le futur.
(Dans mon essai "Orwell & les Gilets jaunes", je reviens de façon moins partisane que Maya Kandel sur la révolution MAGA, dans un chapitre intitulé "C'est quoi Trump ?" : le phénomène Trump est en effet intéressant à observer en raison des analogies entre la révolution MAGA et celle des Gilets jaunes, qui ont débordé en 2019 les digues des partis politiques institutionnels, comme les MAGA en 2016.)
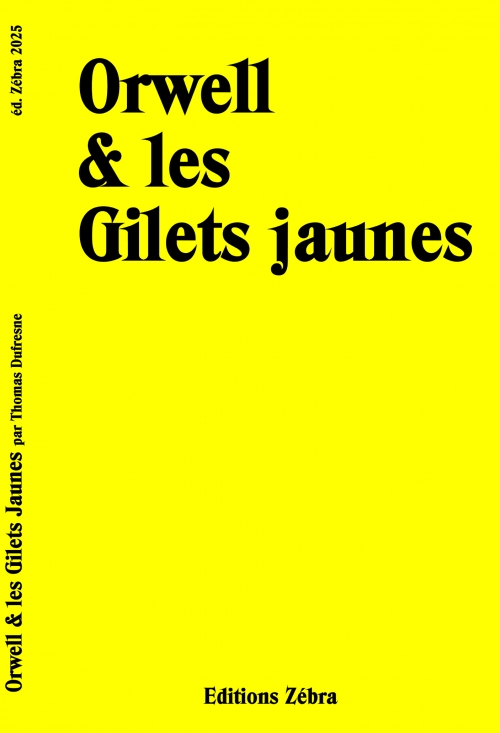
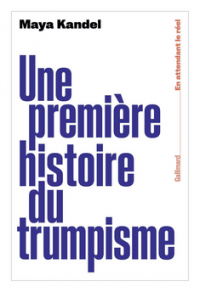 d’expliquer pourquoi l’espoir d’avènement d’une démocratie aux Etats-Unis, formulé à la fin du XIXe siècle par le publiciste libéral A. de Tocqueville, pourquoi cet espoir a été très tôt déçu ? Autrement dit, comment un régime oligarchique démagogique a-t-il pu s’imposer au lieu de la démocratie espérée ?
d’expliquer pourquoi l’espoir d’avènement d’une démocratie aux Etats-Unis, formulé à la fin du XIXe siècle par le publiciste libéral A. de Tocqueville, pourquoi cet espoir a été très tôt déçu ? Autrement dit, comment un régime oligarchique démagogique a-t-il pu s’imposer au lieu de la démocratie espérée ?