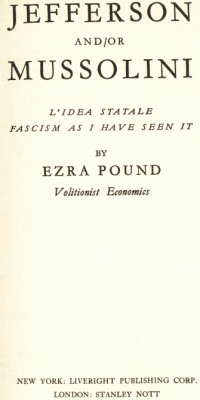L'indice NASDAQ est l'indice vedette de la Bourse de New York car c'est l'indice des valeurs technologiques. Elles ont pris, au stade de sa désindustrialisation, une importance prépondérante dans l'économie américaine. Il est trop tôt pour dire si le développement de l'intelligence artificielle sera la poule aux oeufs d'or que les médias annoncent, mais d'ores et déjà les investisseurs inondent de leurs milliards les entreprises spécialisées dans le développement de cette technologie.
Il n'est donc pas tout à fait exact de dire que la technologie a, au cours du XXe siècle, entièrement colonisé la notion de Progrès, transformant celui-ci peu à peu en une sorte de religion animiste du gadget technologique, religion qui a englouti l'Art au passage.
Le développement technologique débridé, au point de doter le foyer bourgeois moyen de deux ou trois voitures, n'est pas un développement technologique : il obéit à une logique d'investissement capitaliste, ce qui explique que le bilan ne soit jamais fait de tel ou tel "progrès technologique".
Bien que les preuves abondent a posteriori de l'inefficacité de la nouvelle technologie vaccinale ARN pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, aucun bilan médical sérieux n'est fait : non seulement cela entamerait définitivement la crédibilité des politiciens qui en ont fait la panacée universelle, mais encore cela risquerait de brider les futurs investissements dans l'industrie pharmaceutique. Qui a le plus à gagner à la confusion de la science et de la science-fiction ? Les banques d'investissement, qui jouent nos vies aux dés.
L'étouffement de l'Art, son ensevelissement sous la production industrielle et la culture de masse, a suscité en France, dès la fin du XIXe siècle, des réactions dans les milieux culturels et artistiques. Le destin de l'Allemagne industrielle et son culte de la technologie a donné raison à ceux qui voyaient dans la bourgeoisie industrielle un retour de la barbarie. Est-ce qu'une nation s'est plus enivrée de progrès technologique que l'Allemagne nazie ?
Quelques penseurs réactionnaires néo-païens, à commencer par Nietzsche, ont essayé de mettre la barbarie moderne, le "règne de la quantité", sur le compte de la culture chrétienne prométhéenne. On peut soupçonner la mauvaise foi de la part de Nietzsche, ou au moins le dilettantisme, car il prétendait avoir lu F. Bacon.
Or Bacon démontre doublement que le christianisme est une religion prométhéenne (qui ne s'oppose pas à l'élucidation des processus physiques, à la dissection de la Nature) ET que les découvertes technologiques ne sont qu'un fruit, secondaire, de la philosophie naturelle (la science).
Mieux que cela, Bacon a pris soin de prévenir ses disciples du danger de la cupidité humaine, qui sur le terrain de la science peut avoir des effets catastrophiques aussi.
Bacon aurait-il vu dans le catastrophique et barbare XXe siècle une ère prométhéenne ? Certainement pas, puisque la technologie a échappé à l'homme au cours de ce siècle, comme la créature du Dr Frankenstein lui échappe ; loin de maîtriser la technologie, l'Allemagne nazie s'est retrouvée sous un déluge de feu mortel. Qui sait si la Chine, en usant et abusant de l'eugénisme, ne s'est pas suicidée sans le savoir ?
"Le pouvoir n'est pas corrompu en soi, c'est l'homme qui l'est.", dit Bacon ; il en va de même du pouvoir technologique.
Notre époque paraît bien plutôt "épiméthéenne", non seulement à cause de la résurgence de l'islam, mais en raison de la passivité extrême des masses, rassemblées sous le nom de "grandes démocraties", et qui cultivent le progrès sous la forme du gadget et de la performance. Rien de plus épiméthéen que le confort intellectuel.
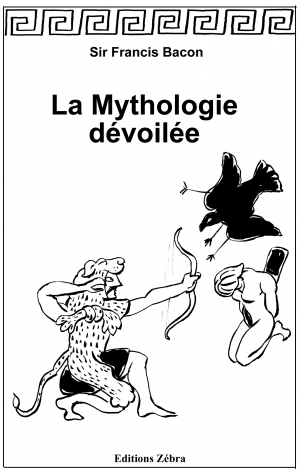 la philosophie. Ce chapitre permet de comprendre que Bacon ne conçoit pas la philosophie séparée de la science physique, amenée à progresser au fil du temps ; la philosophie ne doit donc pas être négligée, bien au contraire, mais elle ne doit pas non plus être mélangée ou confondue avec la Foi des apôtres, comme elle fut au moyen-âge selon un mauvais procédé nuisible aussi bien à la Foi qu'à la philosophie.
la philosophie. Ce chapitre permet de comprendre que Bacon ne conçoit pas la philosophie séparée de la science physique, amenée à progresser au fil du temps ; la philosophie ne doit donc pas être négligée, bien au contraire, mais elle ne doit pas non plus être mélangée ou confondue avec la Foi des apôtres, comme elle fut au moyen-âge selon un mauvais procédé nuisible aussi bien à la Foi qu'à la philosophie.